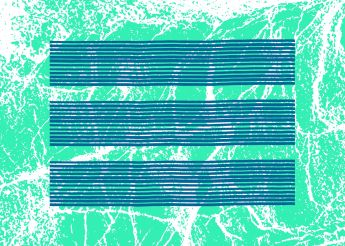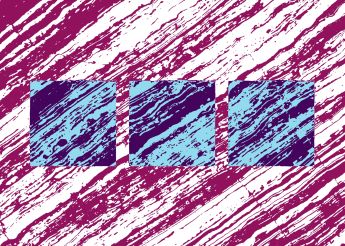Maxime Bissay. L’une des premières barrières à l’accès à la justice est la pauvreté. De nombreuses personnes n’ont pas les moyens d’engager un.e avocat.e pour défendre leurs droits ou de suivre les procédures nécessaires. La corruption touche l’ensemble du système judiciaire, de la police à la magistrature. Les dossiers n’avancent pas sans une aide financière et les décisions favorables sont souvent conditionnées aux pots-de-vin. Les personnes moins nanties sont conscientes que celles disposant de moyens peuvent contourner la loi. Le manque de confiance vis à vis des institutions judiciaires, vues comme inégalitaires et inefficaces, est généralisé.
L’accès à la justice pour les personnes détenues demeure largement théorique. La loi prévoit, pour les personnes démunies, une assistance judiciaire avec un.e avocat.e commis.e d’office. Leurs honoraires sont cependant dérisoires, souvent impayés par les juridictions. Ces avocat.es s’investissent peu, et leurs dossiers de défense sont rarement considérés comme prioritaires.
D’autres facteurs mettent à mal l’accès à une justice équitable, pourtant garanti par la Constitution et le code de procédure pénale camerounais. Le manque de juges limite la transparence et la mise en œuvre des procédures, malgré la formation de professionnel.les dans les écoles de la magistrature. Le budget des tribunaux n’est pas public.
Plus de la moitié des personnes en détention n’ont, selon les données officielles, pas encore été jugées - un chiffre sous-évalué selon les organisations de la société civile.
La détention provisoire ne peut excéder une durée de trois à douze mois, selon la gravité de l’infraction, renouvelable une seule fois. J’ai pourtant rencontré des personnes détenues qui attendaient leurs procès depuis deux ans, voire trois. La lenteur des procédures s’explique également par l’éloignement géographique entre les juridictions d’instance et les cours d’appel, une par région du pays.
Les personnes condamnées en première instance peuvent contester la décision, mais les dossiers ne sont pas transmis systématiquement à la cour d’appel. De plus, si les personnes détenues n’ont pas les moyens de se rendre dans la ville où siège la cour compétente, leurs dossiers finissent par tomber dans l’oubli. Leur seul espoir repose alors sur le soutien des organisations de défense des droits humains.
Les défis sont encore plus grands pour les personnes accusées de terrorisme ou d’implication dans la crise anglophone. Leurs dossiers sont jugés par une juridiction militaire, sans la garantie des droits prévus par la procédure pénale. La durée de leur détention provisoire dépasse régulièrement la limite légale de six mois renouvelable une fois. Les personnes soupçonnées de terrorisme sont fréquemment présumées coupables avant même d’être jugées.