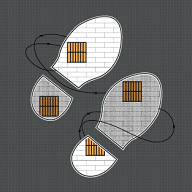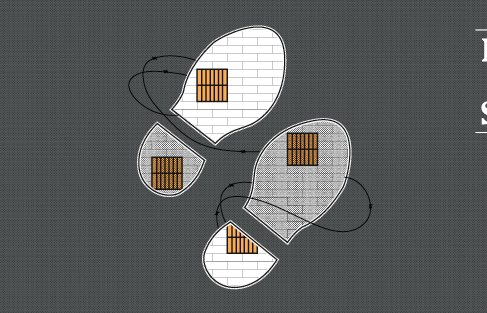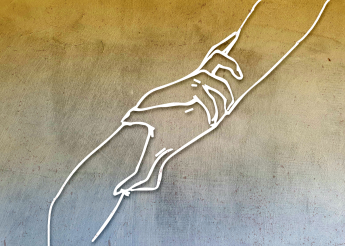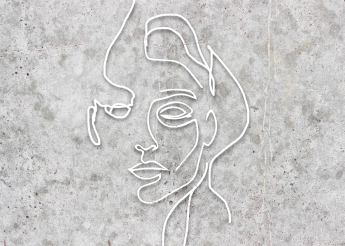Le parloir, ça ne m’a jamais énormément boosté, contrairement à d’autres détenus. C’était dur de voir mes proches enfermés dans une pièce de la taille d’un WC. Ça me faisait du bien sur le moment de les voir, de les prendre dans mes bras. Mais ça voulait aussi dire qu’ils voyaient l’endroit insalubre dans lequel je vivais, avec l’odeur de rats morts et d’humidité, la saleté, les chewing-gums collés partout. Et moi je voyais la tristesse dans leurs yeux.
Après chaque parloir, tous les détenus sont systématiquement fouillés. Un jour, je remonte comme d’habitude après la fouille et il y avait beaucoup de monde. Un surveillant, très gentil, me dit “écoute, tu peux redescendre dans ton parloir cinq minutes et en profiter en attendant”. En arrivant, je surprends ma femme et ma fille en train de pleurer. Pour ne pas assister à ça, j’ai fait comme si je ne les avais pas vues pendant quelques secondes.
À partir de ce jour-là, j’ai préféré les avoir au téléphone ou en visio. Je ne sais pas si c’était mieux pour elles, mais ça m’avait vraiment fait trop mal de les voir tristes comme ça après mon départ du parloir.
La détention, en tout cas dans ma situation, ce n’était pas difficile en tant que tel. C’était un peu la même chose que la vie en cité. Ça parlait, ça criait, ça se charriait de la même façon. La seule chose qui changeait vraiment, c’était le sentiment d’être téléguidé par le rythme de la détention. Ce qui faisait vraiment mal par contre, c’était de savoir que la famille souffrait à l’extérieur, c’était d’entendre ma mère au téléphone qui me disait qu’elle aimerait bien que je rentre. J’ai dû apprendre à me détacher de mes proches, à les oublier et à faire en sorte qu’ils n’existent que lors des appels.