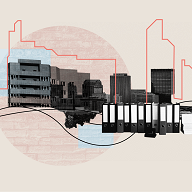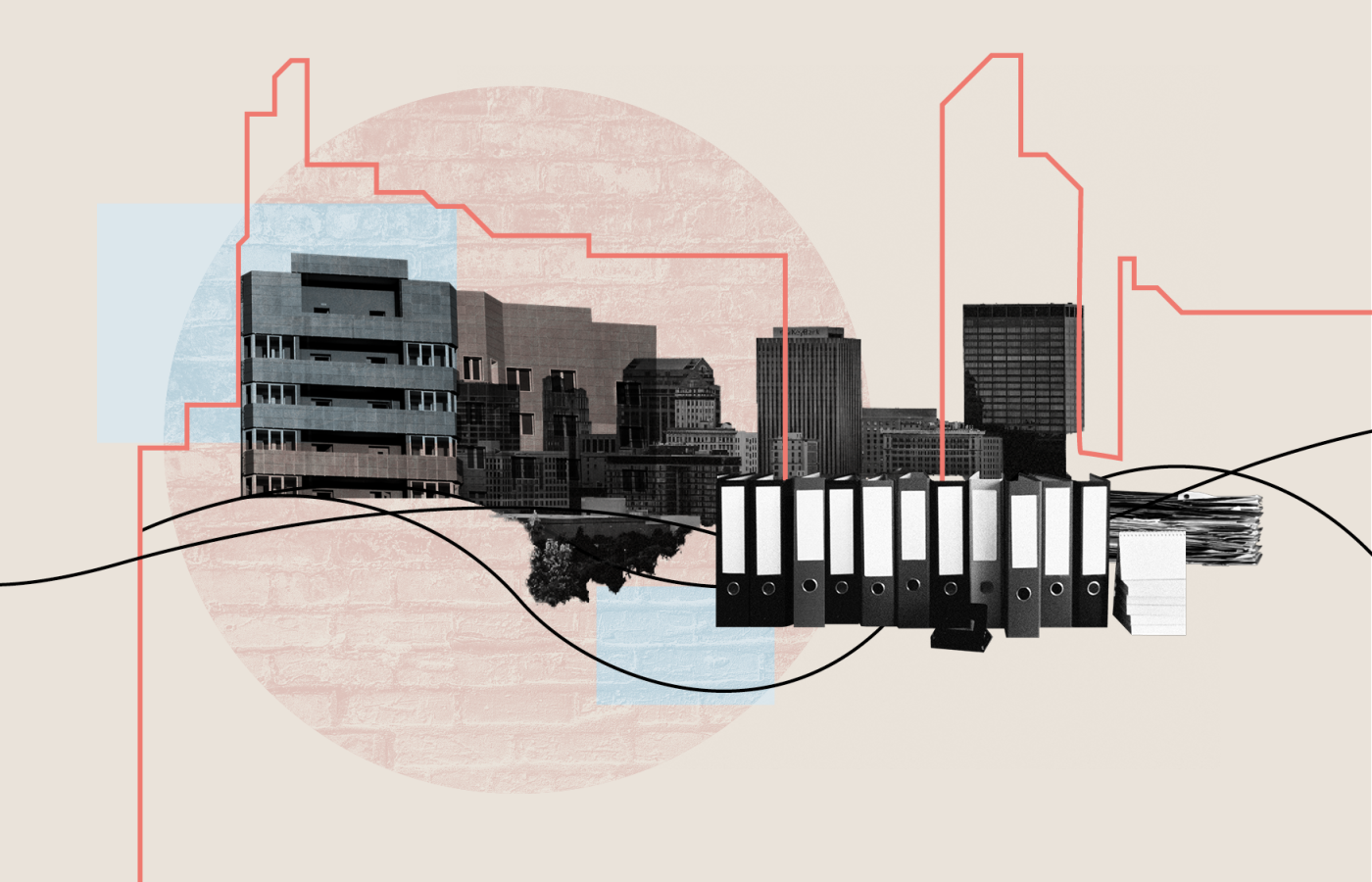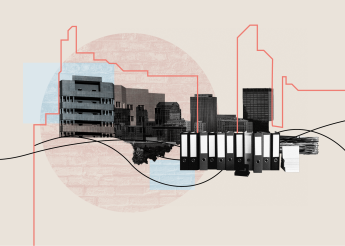Les solutions et les dispositifs ont le mérite d’exister. Mais l’ensemble des personnes rencontrées s’accordent à dire qu’ils sont loin d’être suffisants pour le nombre d’individus dans le besoin. Les listes d’attente s’allongent sans fin, les demandes non satisfaites aussi. Dans un contexte si tendu, est-il encore possible de parler de choix pour les personnes ?
Charlotte Journiac, du programme Passage du MAS (France), souligne que l’angoisse est telle pour les personnes qu’elles sont prêtes à accepter à peu près tout, à l’encontre de leur propre intérêt. “Nous devons leur répéter qu’elles ont le droit de ne pas être d’accord, qu’elles ont cette liberté et que l’on va trouver ensemble une réponse plus adéquate, un autre toit.” Marie-Pierre Noret souligne les risques sociaux, professionnels, de santé et judiciaire que cela peut impliquer, et qui mettre les personnes très rapidement en difficulté. Reza Ahmadi, au Canada abonde dans ce sens : “À cause de ce problème de disponibilité, les personnes sont tellement désespérées qu’elles prennent tout ce qui est disponible, sans tenir compte de leurs besoins. C’est souvent la porte ouverte à l’échec.”
Pour Jane Abad-Martinez et Razika Bizriche du CLLAJ (France), la pénurie de logements et celle de solutions adaptées conduisent à de mauvaises orientations, délétères pour les personnes concernées. “On nous oriente des personnes avec un besoin fort d’accompagnement et de présence constante, que nous ne sommes pas en mesure d’accueillir au CLLAJ.”, expliquent-elles. “Par manque d’autre solution, on nous les envoie quand même, en minimisant les besoins. Une mauvaise solution semble préférable à l’absence de solution, à la rue. Nous tentons le coup, mais tenter c’est aussi un gros risque pour la personne. En tant que travailleuses sociales, nous sommes responsables de dire non. Nous ne voulons plus accepter d’entrer dans de fausses solutions. Nous voulons envoyer un message à l’État pour exiger que les dispositifs soient développés.”
Le nombre de personnes incarcérées, et donc libérées, augmente dans de nombreux pays. Les financements tendent, eux, à suivre le chemin inverse. “Les financements diminuent et pourtant on nous oriente, de plus en plus, des personnes ultra-fragiles.”, constatent Jane Abad-Martinez et Razika Bizriche. “Il n’y a aucune proportionnalité. Comment est-on supposé continuer d’absorber et de répondre correctement aux demandes ?”
En Finlande, le gouvernement a récemment changé de couleur politique et, avec lui, les politiques nationales de lutte contre le sans-abrisme. La société civile se mobilise contre le projet du gouvernement de réduire les subventions publiques aux organisations qui offrent services et soutien aux personnes itinérantes, dont une grosse part de personnes sortant de prison. Les organisations rappellent aux autorités que la réduction de ces financements ne permettra que des économies à court terme, et des coûts accrus à long terme. Elles notent que le besoin de services publics augmente à mesure que les difficultés des personnes s’aggravent, en l’absence de soutien précoce et accessible.
Baisser les financements, c’est aussi laisser libre cours à la concurrence, entre les structures, entre les publics. Les parties prenantes du logement en Finlande la dénoncent ouvertement dans un contexte de crises multiformes : “La tendance est devenue telle qu’il faut être présent, voler l’idée de quelqu’un d’autre et s’asseoir aux bonnes tables pour obtenir de l’argent pour faire fonctionner les dispositifs”, peut-on lire. “Nous ne voulons pas que cette concurrence déloyale perdure. Nous voulons que les parties prenantes jettent leurs efforts dans le même feu de camp, soufflent sur un charbon et que les personnes sans-abri puissent se réchauffer autour. Cela n’est possible que si tout le monde coopère équitablement et si l’argent est distribué équitablement.”
Jane Abad-Martinez et Razika Bizriche déplorent les logiques de financement par appels à projets et les thématiques et publics cibles imposés. “Cela nous oblige à faire du cas par cas, et à faire une hiérarchie entre les situations des personnes, qui ont toutes des besoins énormes, pour essayer de les intégrer dans nos dispositifs”, expliquent-elles.
“Beaucoup de jeunes que nous accompagnons n’entrent dans aucune priorité du moment. Ou alors on a atteint le nombre maximum de suivi. Mais on ne peut pas leur dire ‘désolé, votre cas n’entre dans aucune priorité’, donc on essaie, on tente de les mettre dans des cases à tout prix. La logistique mentale derrière est délirante.”
Cette concurrence imposée rime, pour de nombreuses interlocutrices et interlocuteurs, avec le manque de reconnaissance du travail mené. Beaucoup mentionnent la fatigue que cela entraîne au sein des structures, les départs, les non-remplacements.
“La dynamique est très paradoxale : beaucoup plus de contrôle de la part des financeurs, beaucoup plus d’arbitrage mais de plus en plus de besoins”, déplore Jane Abad-Martinez. “Tout cela meurtrit le terrain et au bout de la chaine, les salariés quittent les structures associatives car ils sont épuisés.”
Au Canada, les Sociétés John Howard d’Ontario et du Québec mentionnent les problèmes d’effectif qu’elles rencontrent et qui aggravent le temps d’attente des personnes dans le besoin. Reza Ahmadi regrette les conséquences du manque d’attractivité des structures associatives : “Une grande partie de notre personnel a été embauchée par d’autres institution ou par le gouvernement, qui propose des meilleurs salaires. Nous avons du mal à pourvoir les postes, nous sommes en sous-effectif de 25 %, parce que nous ne pouvons pas être compétitifs. La rotation est énorme, nous passons énormément de temps à former et à recruter, et le personnel qui reste est sous-payé et surchargé de travail.”